À la reconquête de la trame turquoise : un réseau de mares pour la continuité écologique (49)
Au nord du Maine-et-Loire, à l’ouest d’Angers, la Communauté de communes des Vallées de Haut-Anjou est labellisée « Territoire Engagé pour la Nature ». Elle se caractérise par un paysage très bocager avec un linéaire de haie de 106 m/ha, supérieur à la moyenne départementale (50m/ha).
Le territoire compte aujourd’hui 3 319 mares, principalement d’origines humaines, créées pour l’abreuvement du bétail ou la construction locale.
Depuis 2018, trois programmes de travaux ont permis d’en restaurer 115. La recréation d’une trame turquoise, assurant la continuité écologique des espèces, se poursuit avec une ambition de restaurer 15 mares par an, soit 200 d’ici 2030.






Entretien avec Jean-Pierre Bru et Romain Stasse

Ce projet est présenté par :
- Jean-Pierre Bru, agriculteur retraité, vice-président en charge de la voirie, de l’environnement et de l’assainissement de la CC Vallées du Haut-Anjou, vice-président du syndicat Edenn et maire de la commune déléguée du Louroux-Béconnais (Commune de Val d’Erdre Auxence)
- Romain Stasse, responsable environnement et mobilités à la CC Vallées du Haut-Anjou
Parole de collectivité
Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets de gestion de l’eau sur votre territoire, aquagir part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action
Comment la restauration d’un réseau de mares s’est-elle imposée à l’agenda de votre collectivité ?
Jean-Pierre Bru : En 2016, nous avons réalisé un inventaire des haies via des groupes de travail communaux (élus, chasseurs, club nature…) avec pour objectif de restaurer notre bocage angevin. Très vite, les élus ont souhaité aussi agir sur les mares qui composent le triptyque bocager : haie, mare et prairie. Les mares, devenues moins utiles, se sont progressivement fermées par envasement avec l’arrivée de l’eau courante dans les campagnes et le déclin de l’élevage. Le recalibrage des cours d’eau dans les années 1970-1980 a entraîné un abaissement des niveaux d’eau et une accélération du ruissellement agricole, rendant le territoire plus vulnérable à la sécheresse et aux inondations. La restauration des mares permet, entre autres, de recréer des zones tampons pour retenir l’eau.
Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?
Jean-Pierre Bru : Nous avons tout construit du début à la fin, étant les seuls sur ce sujet au départ. Nous avons fait un inventaire des mares en 2023-2024 avec un Modèle numérique de terrain (MNT), une modélisation de l’altitude du sol naturel, capturée par drone ou avion par l’IGN à l’échelle départementale. Nous l’avons utilisé pour repérer les dépressions, qui sont des indicateurs potentiels de présence de mares. Cette pré-cartographie a été affinée par photo-interprétation d’images aériennes et surtout par des ateliers participatifs. Des habitants bénévoles qui connaissent bien leur commune ont vérifié la présence de mares sur le terrain. Ces étapes ont permis de fiabiliser la cartographie à 90%. L’objectif est maintenant de sanctuariser ces espaces en les intégrant dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Cela garantira la préservation de ce patrimoine aquatique, les reconnaissant officiellement comme des zones humides potentielles, puis effectives après inventaires de terrain.
Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?
Romain Stasse : Nous avons adapté aux mares les méthodes de renaturation des cours d’eau initiés par nos syndicats de bassin versant. Après avoir réalisé les diagnostics écologiques des mares, nous utilisons un arbre de décision et une grille d’évaluation pour prioriser les interventions, favorisant les mares s’intégrant dans une trame turquoise. Au fur et à mesure, nous avons appris de nos erreurs et affiné la méthode. Nous évitons les projets en copropriété et sommes très vigilants sur l’accessibilité de la parcelle et des réseaux souterrains. Nous veillons à limiter notre impact : intervention hors des périodes de fréquentation de la mare par les espèces cibles, maintien de banquette végétale comme lieu de refuge pour les espèces… Des sondages pédologiques sont désormais réalisés pour garantir la rétention d’eau lorsque nous créons des mares. Nous mettons en place des suivis biologiques rigoureux avant et après les travaux, à 1, 3 et 5 ans. Ces inventaires respectent des protocoles standardisés et les données sont publiées sur l’Inventaire national du patrimoine naturel. Un rapport scientifique de 2024 confirme des gains écologiques importants, avec une multiplication par 2 à 4 du nombre d’espèces d’amphibiens et de libellules, et la recolonisation par le triton crêté ou le pélodyte ponctué par exemple. Un entretien régulier des mares est nécessaire, sans cela les gains écologiques diminuent après cinq ans.
Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?
Jean-Pierre Bru : Les démarches administratives sont nombreuses mais elles aident à structurer le projet. Les Contrats Territoriaux Eau ont permis une instruction et une mutualisation des financements, ce qui simplifie le dossier. La phase de concertation avec les agriculteurs et les propriétaires est importante dans la réussite du projet. Cela nécessite un travail de terrain des élus et techniciens. Les mares sont un atout pour les agriculteurs car elles réactivent l’abreuvement du bétail, retardent l’utilisation de tonnes à eau et économisent ainsi l’eau potable. Les agriculteurs s’engagent à installer des clôtures et des pompes à museau, pour l’accès du bétail à l’eau sans piétiner dans la mare. Les mares sont aussi des points d’eau vitaux pour la faune sauvage.
Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?
Jean-Pierre Bru : Au démarrage, nous avons privilégié les mares communales et celles situées le long des sentiers de randonnée, pour valoriser le paysage. Nous ciblons aussi les mares pour créer une continuité écologique, avec 500 mètres maximum de distance entre elles. Notre rythme d’intervention est désormais de 15 mares par an. Les habitants sont globalement favorables au projet de restauration des mares et en ont compris l’intérêt. On constate une vraie reconnaissance pour ces petits milieux. Les mares sont perçues comme des points d’agrément et de fraîcheur. Certains ont pu être choqués par les travaux mais la recolonisation rapide de la nature après restauration a permis l’adhésion du plus grand nombre. 11 panneaux d’interprétation sensibilisent le public, l’incitent à observer et à prendre soin de ces milieux. Chaque année, des animations à destination des scolaires et du grand public sont aussi proposées (visite terrain, randonnée mares…).
Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?
Jean-Pierre Bru : Le premier programme de restauration de mares (2018-2021) recevait des aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région. Le programme actuel (2024-2026) est financé par le Contrat Territorial Eau des Basses Vallées Angevines, à 54% par le Département de Maine-et-Loire et 26 % par la Région Pays de la Loire. Le montant global de ce programme triennal est de 163 500 € HT, soit un reste à charge de 32 700 € pour la collectivité. Les agriculteurs installent clôtures et pompes à leurs frais autour des mares qui servent à l’abreuvement. L’intercommunalité finance également des barrières en bois lorsque les mares sont à proximité d’aire de jeu ou au bord des sentiers de randonnées.
Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné la communauté de communes Vallées du Haut-Anjou la préparation et la réalisation de ce projet ?
Jean-Pierre Bru : L’association Eden 49 est un partenaire majeur et très précieux agissant comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour la définition des projets, les suivis biologiques, le montage les dossiers de subvention et la conduite des chantiers. La contribution des agriculteurs et propriétaires fonciers est essentielle, ils mettent leurs terrains à disposition et s’engagent à l’entretien. Les groupes de travail locaux, composés d’élus, agriculteurs, chasseurs et associations, ont également participé activement à l’inventaire des mares.
Romain Stasse : L’unité mixte de recherche de l’Université d’Angers (UMR CNRS 6554 LETG-LEESA) et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont collaboré sur la définition d’un modèle de dispersion des amphibiens pour cartographier la trame turquoise et prioriser les interventions sur les mares fonctionnelles. Le CPIE Loire-Anjou a apporté son expertise, notamment pour la vulgarisation scientifique des inventaires et a produit un rapport scientifique attestant des gains écologiques significatifs après la restauration des mares. Deux structures d’insertion par l’activité économique (Solipass et Asure) effectuent deux passages par an pour nettoyer les 11 panneaux d’interprétation installés près des mares et les débroussailler.
Profitez d’une offre de financement des projets en faveur de l’environnement : gestion de l’eau, etc.

Le projet en détails
Dates clés
2016
2016 - 2018
2018 - 2021
Depuis 2018
Chiffres clés
3 319
163 500
200
Résultats
Amélioration de la biodiversité : Pour les groupes étudiés (odonates, amphibiens, flore), le nombre d’espèces est en moyenne 2 à 4,5 fois plus important après restauration qu’avant les travaux.
À retenir
Les mares restaurées servent à nouveau à l'abreuvement du bétail, elles sont des îlots de fraîcheur, luttent contre les inondations et améliorent le cadre de vie.
Les mares offrent un support de sensibilisation à l’environnement et recueillent l’adhésion des habitants.
Le maintien de l'entretien continu des mares par les propriétaires est un défi majeur, car une légère diminution du nombre d'espèces et une fermeture progressive des mares sont observées après cinq ans. L'arrivée potentielle d'espèces exotiques envahissantes (comme le Xénope lisse ou l'Azolla) représente une menace pour les écosystèmes restaurés. Lors d'années très sèches (comme 2022), certaines mares se sont asséchées et ne se sont pas remises en eau les années suivantes à cause de l'éclatement de l'argile qui perd son étanchéité.
Ressources
Haut anjou : En Anjou. Les mares régénèrent la nature
La communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) met en œuvre depuis 2018 un ambitieux programme de restauration des mares bocagères
Les partenaires de ce projet

Agence de l'Eau Loire-Bretagne

CPIE Loire-Anjou

Association Eden 49

Région Pays de la Loire
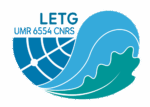
Unité mixte de recherche de l’Université d’Angers (UMR CNRS 6554 LETG-LEESA)

Département Maine et Loire

Université de Pau et des Pays de l'Adour
En savoir plus sur la communauté de communes des Vallées de Haut-Anjou
habitants
communes membres
Données de contact
Les autres projets - Gestion des milieux aquatiques
Dans l’Aube (10), une vaste restauration hydromorphique de l’Armance, du Landion et de leurs zones humides
À la reconquête de la trame turquoise : un réseau de mares pour la continuité écologique (49)


Renaturation de la rivière du Colostre à Saint-Martin-de-Brômes et Allemagne-en-Provence (04)


Vous êtes passés à l'action sur la gestion de l'eau ?



