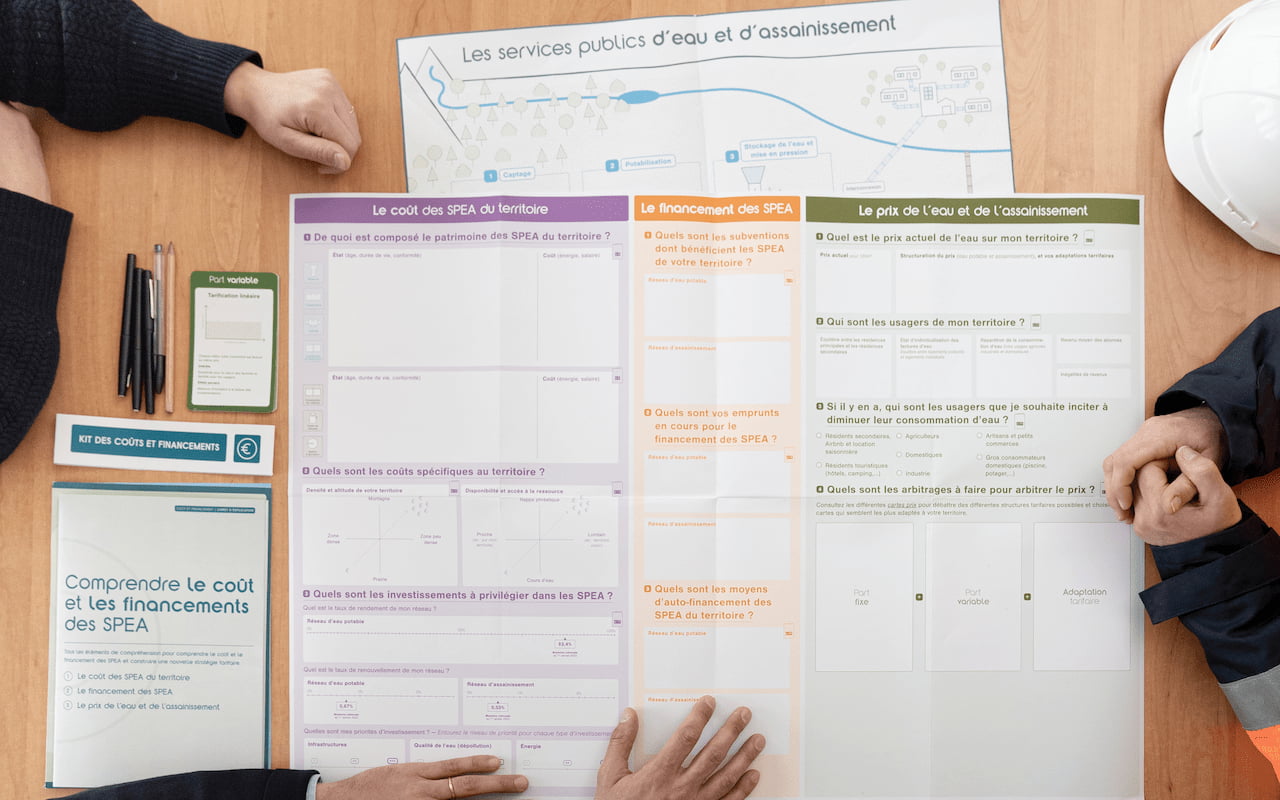Chacun des modèles – tarification uniforme, tarification progressive, tarification dégressive, tarification sociale, tarification saisonnière – poursuit un ou des objectifs, présente des avantages, des risques ou inconvénients et des prérequis. Tour d’horizon pour cerner chaque tarification et identifier les paramètres utiles à la prise de décision.
Tarification de l’eau : principes et réalités
Il est d’usage de dire que l’eau en tant que ressource naturelle indispensable à la vie n’a pas de prix mais que les services rendus aux utilisateurs – le prélèvement, le traitement, la distribution, l’épuration après usage, etc. – ont un coût.
Facturé à l’usager et fixé par la collectivité organisatrice, responsable des services publics d’eau et d’assainissement sur son territoire, la tarification repose sur deux principes fondamentaux : « l’eau paie l’eau » et le principe « pollueur-préleveur-payeur ». Or, avec la nécessaire sobriété dans les prélèvements et les usages, les conséquences sur la qualité de l’eau de sa raréfaction et les investissements requis notamment sur les infrastructures eau potable et assainissement, ce système de financement ne tient plus. On parle d’effet ciseau, une situation où les recettes baissent et les charges augmentent (cf. à cet égard l’entretien avec Régis Taisne, chef du département Cycle de l’eau à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Cela conduit notamment à s’interroger sur les tarifications possibles et pratiquées au regard de la seule consommation d’eau des usagers (la part fixe ou abonnement et les taxes et redevances des factures sont donc mises de côté dans cet article).
La recherche d’un juste tarif doit avoir pour premier objectif de couvrir les besoins de financements des services d’un territoire donné puisque les situations sont très diverses. Mais l’augmentation inévitable du prix (il y a là consensus de tous les acteurs du webinaire “Comment financer durablement les services publics de l’eau ?“ proposé par le Hub des territoires le 1er juillet 2025 et disponible en rediffusion) doit être pensée au regard de la typologie des usagers et du prix déjà pratiqué pour une bonne acceptation.
| Prix moyen des services de l’eau et paramètres de variation En 2022, selon le rapport 2024 de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, le prix moyen, toutes taxes comprises (TTC), des services de l’eau s’élève à 4,52 euros le mètre cube (2,21 €/m3 pour la part de l’eau potable et 2,31 €/m3 pour l’assainissement collectif) pour une consommation annuelle de 120 m3 par ménage. Évidemment dans les faits, le prix moyen varie au gré de différents facteurs liés pour l’essentiel au contexte local : qualité et proximité de la ressource en eau, vétusté et taille des équipements, densité de la population, charges financières des. Autre facteur déterminant : la taille des services en nombre d’habitants desservis (poru approfondir cette question, lire Prix de l’eau : comment facturer un bien commun ?). |
Quatre grands modèles de tarifications de l’eau
Au gré des différents textes réglementaires (loi Brottes, Plan eau…), se dégagent quatre grands modèles de tarification :
- Tarification uniforme : le tarif au mètre cube est identique quel que soit le volume consommé
- Tarification progressive : le tarif au mètre cube croît à mesure que la consommation augmente.
- Tarification dégressive : le tarif au mètre cube décroît à mesure que la consommation augmente.
- Tarification différenciée : elle s’oppose au tarif unique et permet des tarifs différents selon les catégories d’usagers.
À noter aussi l’existence d’un tarif forfaitaire : ce type de tarification ne concerne que certaines collectivités de moins de 1 000 habitants ayant une ressource en eau abondante. Elle n’est possible que sur autorisation dérogatoire du préfet. Le prix payé est alors le même, quelle que soit la consommation d’eau du ménage.
La tarification uniforme
La tarification uniforme (le tarif au mètre cube est identique quel que soit le volume consommé) est le modèle le plus répandu à date. Et puisque le prix du m3 relevait de la compétence de chaque commune, cette tarification pouvait varier d’une commune à l’autre, entrainant de grandes disparités sur un territoire donné et au niveau national. Le transfert de compétence aux communautés ou agglomération de communes ou la constitution de grandes métropoles a permis dans certains cas d’engager un travail de fond afin d’uniformiser sur leur territoire le prix du m3 (lire Eau potable – Prix unique de l’eau : quand des collectivités donnent l’exemple).
Récemment, Mulhouse Alsace agglomération a pris la décision de s’acheminer vers une tarification unitaire de l’eau, programmée pour 2028, afin de mettre fin à de grandes disparités : en janvier 2024, le tarif du m3 d’eau dans les communes de l’agglomération variait de 0,6870 euro à 2,3820 euros. Construit dans la concertation avec les différents acteurs (représentants des communes, de la société civile et de la régie de l’eau), ce dispositif de convergence vers un prix unique du m3 concerne la partie fixe et la partie variable. Son indexation sur l’inflation est programmée et la présentation des factures sur un même modèle a également été décidée. La convergence tarifaire sera progressive avec un étalement sur huit ans et un objectif tarifaire, en moyenne pondérée, de 1,7007 euros TTC par m3 à échéance (la part fixe est harmonisée depuis le 1er janvier 2025).
S’inscrivant dans une logique égalitaire face à une ressource essentielle et de mise en œuvre simple comparée aux autres modèles, une telle tarification ne répond pas toutefois à l’équité sociale ni ne favorise la sobriété.
La tarification dégressive
Pour rappel : tout tarif dégressif est interdit depuis le 1er janvier 2010, sauf lorsque plus de 70% des prélèvement destiné à l’alimentation en eau potable sur le secteur du service ne sont pas faits en Zone de Répartition des Eaux.
La tarification dégressive permet à certains usagers de payer moins cher à mesure que leur consommation augmente. La logique est ici celle de l’efficience économique : on entend favoriser les usages dont la valeur est la plus intéressante pour la collectivité, donc les activités économiques qui vont vivre le territoire.
Compte tenu du grand défaut de cette tarification – contrecarrer l’impérieuse sobriété -, le Conseil économique, social et environnemental préconise sa suppression d’ici 2030. Au risque, selon certains, d’une multiplication des forages privés (intervention d’Hervé Reynaud, sénateur (LR) de la Loire : Sénat, 19 déc. 2023).
Bon à savoir : il existe des modèles mixant tarif progressif puis tarif dégressif (courbe en cloche) passé un certain niveau de consommation.
La tarification progressive
Le principe ? Un prix bas, proche du prix coûtant pour les volumes d’eau indispensables aux usages essentiels par habitant pour le soin, l’hygiène, la cuisine puis des prix plus élevés pour des usages de confort : arrosage, remplissage de piscine, nettoyages non indispensables…
La communauté urbaine de Dunkerque qui a adopté ce principe dès 2021, a découpé sa tarification en trois tranches : l’eau essentielle– les 80 premiers m3, puis l’eau utile (jusqu’à 200 m3) et au-delà l’eau de confort. Pour la première tranche, une tarification sociale a également été introduite pour les foyers bénéficiant de la complémentaire santé solidaire. Libourne et, depuis le 1er janvier 2023, Montpellier ont aussi instauré une tarification progressive de l’eau. Mauge communauté, confrontée à un besoin d’investissement de 200 millions d’euros sur 10 ans pour assainissement et eau potable, a aussi fait le choix d’une tarification progressive en 2021. Elle a remplacé les différentes tarifications pratiquées sur les communes « par une trajectoire de convergence tarifaire en menant en parallèle un gros travail de récupération des données pour parvenir à une connaissance fine » a partagé Christophe Dougé, vice-président grand cycle de l’eau de Mauge communauté lors du webinaire du Hub des territoires du 1er juillet 2025. C’est là un écueil important de cette tarification qui attire bien des regards : avoir accès aux données de consommation (nécessité d’installer des compteurs individuels) mais aussi aux données fiscales ou de la Caf (pour connaitre la composition du foyer et donc ne pas pénaliser les familles nombreuses par exemple)…
Penser pour agir en faveur de la sobriété en faisant peser le gros de l’effort de financement sur les grands consommateurs, la progressivité du prix a pour objectif de responsabiliser les usagers ce qui permet à ces derniers d’agir pour diminuer leurs factures. Toutefois, un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de novembre 2023 relève que les conditions d’une généralisation de la tarification progressive ne sont pas réunies en raison de la complexité de sa mise en œuvre et que les résultats sur la consommation d’eau sont mitigés.
Par ailleurs, en l’état actuel du système de financement où “l’eau paie l’eau“, la réduction des consommations d’eau conduit à une augmentation du prix de l’eau ce qui fait que le budget consacré à l’eau par les usagers ne baisse pas significativement. Une attitude vertueuse est donc potentiellement sanctionnée par une augmentation du prix de l’eau à terme.
La tarification différenciée : objectif social, objectif de soutenabilité
Utilisée pour prendre en compte la situation des ménagers précaires ou bien la forte affluence de population en période estivale, la tarification différenciée permet une approche selon la catégorie d’usagers considérée.
La tarification sociale
La tarification sociale peut se matérialiser de différentes manières :
- Définir des tarifs tenant compte de la composition des foyers ou de leurs revenus ;
- Attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou encore une aide d’accès à l’eau ;
- Accompagner financièrement les usagers à réaliser des économies d’eau ;
- Créer une première tranche de consommation gratuite ;
Dispositif mis en place à l’initiative des collectivités afin de réduire la facture d’eau des usagers les plus modestes ou de les aider à en payer une partie, cette logique permet d’augmenter le pouvoir d’achat des usagers les plus modestes, contribue à la diminution du taux d’impayé et donc à l’équilibre financier des services d’eau et d’assainissement.
Comme dans l’exemple de la ville de Dunkerque, la tarification sociale peut être appliquée par le biais d’une tarification progressive, et donc s’inscrire dans une démarche de préservation de la ressource en eau.
La tarification saisonnière
A Serra di Ferro en Corse, où la population passe de 650 habitants l’hiver à 7 000 l’été, la tarification différenciée a été mise en place afin « d’éviter de faire peser sur nos administrés qui vivent ici à l’année, le poids de surcoûts dans nos investissements et dans l’entretien des équipements, liés notamment à la forte pression démographique pendant la saison et au tourisme dans la région, explique Jean Alfonsi, maire de la commune de Serra di Ferro & Vice-Président de l’association des maires et présidents d’EPCI de la Corse-du-Sud. La mise en place d’une tarification estivale a été rendue possible par la pose de compteurs numériques qui permettent cette télérelève de la consommation. Elle s’effectue au 1er juin et au 30 septembre. Ce sont les deux bornes d’une tarification, que l’on pourrait qualifier d’hiver (8 mois) et d’été (4 mois), dans ces intervalles. »
À Toulouse Métropole aussi, le prix de l’eau varie avec les saisons : depuis le 1er juin 2024, pour les habitants de la métropole toulousaine, le mètre cube, dont le prix de base est à 3,34 €, augmente de 42 % pendant les cinq mois d’été, du 1er juin au 31 octobre. Puis, il descend à 2,58 €, soit moins 30 %, pendant le reste de l’année. Dans la métropole, 70 % de l’habitat est collectif, avec un compteur partagé. La métropole a donc imaginé des coefficients, calculés pour être neutres en cas de consommation constante, mais significatifs en cas d’augmentation de la consommation l’été.
Comme pour la tarification progressive, la tarification différenciée, saisonnière ou sociale, requiert l’accès aux données et/ou des installations (compteurs numériques) ou de l’imagination comme à Toulouse. Surtout, les usagers soumis aux tranches supérieures de la tarification différenciée peuvent estimer qu’ils souffrent d’inégalités de traitement. D’où l’importance d’une stratégie de communication structurée et claire … nécessaire quel que soit le choix de la tarification car comme l’a rappelé Christophe Dougé, vice-président grand cycle de l’eau de Mauge communauté lors du webinaire du Hub des territoires du 1er juillet 2025 : « il faut communiquer sur le prix et le fait que cela va augmenter régulièrement (…) et communiquer sur le service rendu, notamment la qualité : 1,50 euros par jour par foyer pour bénéficier d’une eau de qualité et épurée, c’est très raisonnable. »
Aucun modèle de tarification ne s’impose en lui-même dans un strict rapport prix/consommation. C’est le contexte local qui doit guider le choix de l’autorité décisionnaire. Le bon équilibre peut se trouver dans un savant mix des différents modèles tarifaires possibles. L’évidence est que certes la nécessaire modernisation des réseaux va mettre fin, à court et moyen terme, à une eau bon marché. Mais les coûts croissants de traitement de l’eau pour faire face aux rejets polluants ne doivent pas être oubliés et la question de la contribution des émetteurs de ces polluants et de la réduction de ces derniers.