Cap Blanc, situé à Lavelanet de Comminges (31), se mobilise pour préserver une ressource vitale
Face à des concentrations alarmantes en nitrates et en pesticides dans la nappe de Cap Blanc, à Lavelanet-de-Comminges, en Haute-Garonne, la collectivité a lancé un projet ambitieux pour restaurer cette ressource essentielle.
Grâce à des partenariats stratégiques, des acquisitions foncières et des pratiques agricoles innovantes, les concentrations en nitrates ont été divisées par deux. Porté par le SIECT, le Syndicat intercommunal des Côteaux du Touch, ce modèle de mobilisation collective combine expertise scientifique, financements adaptés et concertation citoyenne.
Cette initiative, étalée sur plusieurs phases depuis 2012, garantit la protection durable d’une ressource vitale pour 52 communes et inspire une agriculture compatible avec la préservation de l’eau.



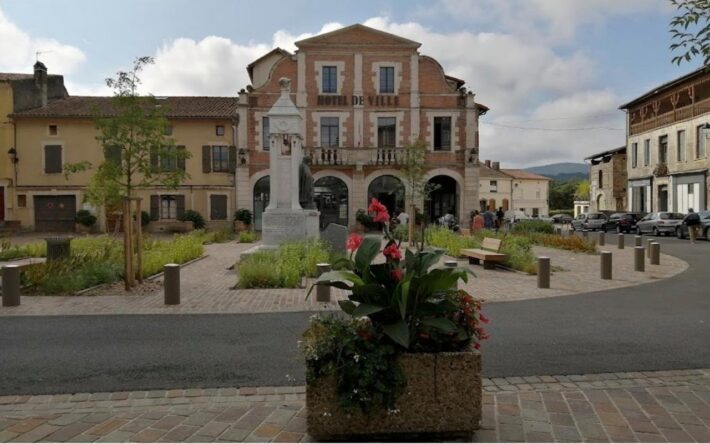
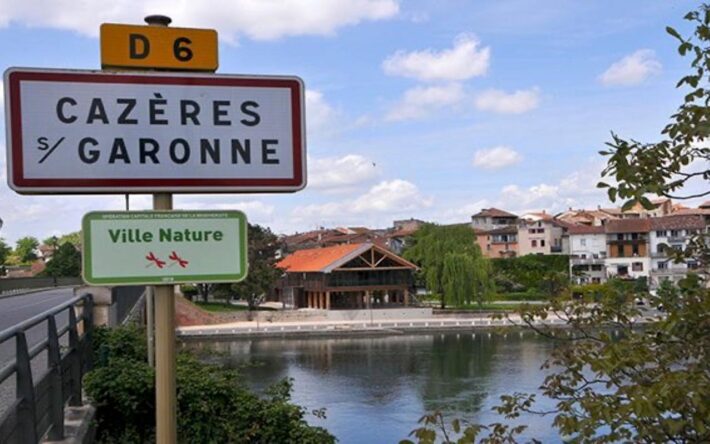
Entretien avec Marc Balawender, animateur au Syndicat intercommunal des Côteaux du Touch

Ce projet est présenté par :
- Marc Balawender, animateur au Syndicat intercommunal des Côteaux du Touch (SIECT)
Parole de collectivité
Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets de gestion de l’eau sur votre territoire, aquagir part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action
Comment ce projet de captage en eau potable s’est-il imposé à l’agenda de votre collectivité ?
Le projet de restauration du captage de Cap Blanc s’est imposé à l’agenda en 2012 lorsque ce captage a été classé prioritaire pour sa vulnérabilité face aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides). Il est la principale ressource alimentant cinq communes environnantes, représentant environ 10 000 habitants, et se trouve dans une zone très perméable, dépendant directement des précipitations.
L’activité agricole dominante dans la région, principalement l’élevage et la culture du maïs, joue un rôle clé dans les pollutions identifiées. En 2012, les concentrations en nitrates atteignaient jusqu’à 70 mg/L, bien au-delà du seuil réglementaire de 50 mg/L, mettant en péril la qualité de l’eau.
Pour remédier à la situation, une dilution temporaire de la nappe avec de l’eau du canal de Tuchan a été instaurée, mais cette solution était inopérante durant les périodes d’entretien du canal. Dès lors, une stratégie pérenne a été élaborée via les Plans d’Actions Territoriaux (PAT), comprenant des actions de sensibilisation, des changements de pratiques agricoles et des acquisitions foncières.
Depuis 2019, le SIECT, en charge de la gestion, a renforcé ses actions via le PAT3, pour garantir durablement la qualité de cette ressource vitale.
Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?
L’élaboration du projet s’est appuyée sur un ensemble de données scientifiques et d’échanges avec des acteurs locaux et nationaux. Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a fourni une cartographie détaillée des flux de la nappe et des zones vulnérables, essentielle pour prioriser les interventions.
La Chambre d’agriculture et les coopératives locales ont apporté leur expertise sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, comme la réduction des intrants et l’introduction de cultures adaptées à la qualité des sols. Par ailleurs, des échanges avec des territoires similaires, comme celui de la vallée de la Garonne, ont permis de s’inspirer de bonnes pratiques, notamment en acquisition foncière et en concertation citoyenne.
Le PAT3 repose sur ces enseignements : réduction des pollutions agricoles, acquisition foncière, sensibilisation publique et suivi scientifique renforcé. Des ateliers citoyens et réunions publiques ont permis de recueillir les attentes des habitants, garantissant une co-construction du projet et un alignement avec les besoins locaux.
Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?
Oui, des études détaillées ont été réalisées en amont et tout au long du projet. Le BRGM a mené des analyses hydrogéologiques pour comprendre le comportement de la nappe et identifier les zones prioritaires. Ces études incluaient l’installation de piézomètres (dispositifs permettant de mesurer les niveaux d’eau et la qualité en différents points) pour surveiller les nitrates et pesticides.
Ces travaux ont révélé des concentrations préoccupantes, dues principalement aux engrais agricoles, et ont orienté les acquisitions foncières vers les parcelles les plus vulnérables. Les études ont aussi défini des objectifs clairs : réduire les intrants agricoles et limiter l’impact des pressions humaines sur la zone.
Des évaluations environnementales et sociales ont permis d’anticiper les nuisances potentielles, notamment visuelles et sonores, et d’adopter des stratégies de communication adaptées pour renforcer l’adhésion des habitants. Ces études, croisées avec des retours de terrain, constituent la base scientifique et technique des actions du PAT.
Concernant les compétences, quelles sont celles à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?
La mise en œuvre de ce projet repose sur une combinaison de compétences techniques, sociales et organisationnelles. Sur le plan technique, une maîtrise de l’hydrogéologie est évidemment indispensable pour comprendre les flux de la nappe, évaluer les risques et dimensionner les actions nécessaires. En agronomie, il faut savoir accompagner les agriculteurs dans la réduction des intrants et le choix de cultures compatibles avec la protection de l’eau.
Sur le plan social, des compétences en communication et en concertation sont essentielles pour dialoguer avec des publics très variés -agriculteurs, riverains, industriels- et garantir leur adhésion. La capacité à vulgariser des données techniques et à organiser des ateliers citoyens est cruciale pour mobiliser et sensibiliser.
Enfin, des compétences organisationnelles sont nécessaires pour coordonner tous les partenaires, gérer les dossiers administratifs (subventions, baux fonciers) et planifier les actions dans le temps. Ce projet exige une approche multidisciplinaire, alliant rigueur scientifique, sens humain et vision à long terme.
Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?
Le diagnostic s’est basé sur les analyses hydrogéologiques du BRGM, identifiant les zones prioritaires et dimensionnant les interventions nécessaires. Par exemple, les parcelles agricoles présentant les plus fortes concentrations en nitrates ont été ciblées pour des acquisitions foncières ou des changements de pratiques.
Pour renforcer l’adhésion citoyenne, une plateforme en ligne a été mise en place, permettant aux habitants de consulter les scénarios et de donner leur avis. Des réunions publiques ont offert un espace d’échanges pour répondre aux préoccupations des riverains et présenter les bénéfices attendus.
Les comités de pilotage trimestriels ont permis une gouvernance inclusive, impliquant les élus des 52 communes concernées. Chaque action validée par vote a été communiquée aux citoyens, établissant une transparence et une confiance durables entre la collectivité et les parties prenantes.
Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?
Le coût global du projet s’élève à environ 3 millions d’euros ; le financement s’est appuyé principalement sur les aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, qui a couvert 70 % des coûts d’animation générale et 80 % des acquisitions foncières et du suivi de la qualité de l’eau. La collectivité a également mobilisé ses propres ressources et contracté des prêts à taux préférentiels pour compléter le budget.
Chaque dépense a été justifiée et validée dans les comités de pilotage, assurant une gestion rigoureuse et transparente. Ce montage financier solide a permis de limiter l’impact sur les finances locales tout en maximisant les subventions disponibles.
Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné la collectivité dans la préparation et la réalisation de ce projet ?
Le succès du projet repose sur une collaboration étroite avec des partenaires variés :
- L’agence de l’Eau Adour-Garonne pour le financement et le suivi.
- La SAFER, facilitant les acquisitions foncières.
- La Chambre d’agriculture et les coopératives agricoles, accompagnant les changements de pratiques.
- Le BRGM, apportant une expertise hydrogéologique pointue.
Des associations, comme Arbres et Paysages d’Autan, contribuant à la réflexion sur l’utilisation des parcelles acquises.
Cette coopération interdisciplinaire a assuré une coordination optimale et des résultats
Profitez d’une offre de financement des projets en faveur de l’environnement : gestion de l’eau, etc.

Le projet en détails
Dates clés
2012 - 2016
2017 - 2023
2024 - 2028
Chiffres clés
41
3 000 000
52
À retenir
La collaboration avec le monde agricole : un partenariat exemplaire a permis d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.
Le montage financier efficace : grâce aux subventions et à une gestion rigoureuse, le projet a été réalisé sans peser sur les finances locales.
Une mobilisation tardive sur le devenir des parcelles acquises : une gestion plus proactive aurait renforcé l’impact et l’adhésion des acteurs et une sécurité difficile à garantir à 100%.
Ressources
Fredon Occitanie - Jamais 2 sans 3 : le SIECT poursuit son action de préservation de la qualité de l’eau du captage de Cap Blanc !
Le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et le soutien technique de la Chambre départementale d’agriculture 31 et de FREDON Occitanie, a renouvelé son plan d’action territorial pour 5 années supplémentaires.
Les partenaires de ce projet

Agences de l’Eau Adour-Garonne

BRGM

Chambre d’agriculture et les coopératives agricoles

SAFER

Arbres et Paysages d’Autan
En savoir plus sur le Syndicat intercommunal des Côteaux du Touch
communes
Données de contact
Les autres projets - Pollutions
Le SMi2B (71) aide les agriculteurs pour lutter contre la pollution de la Bourbince
En Haute-Loire (43), des légumineuses au service de la qualité des sols et de l’eau


Une haie et de la prairie pour protéger le champ captant de Pont du Château (63)


Vous êtes passés à l'action sur la gestion de l'eau ?



